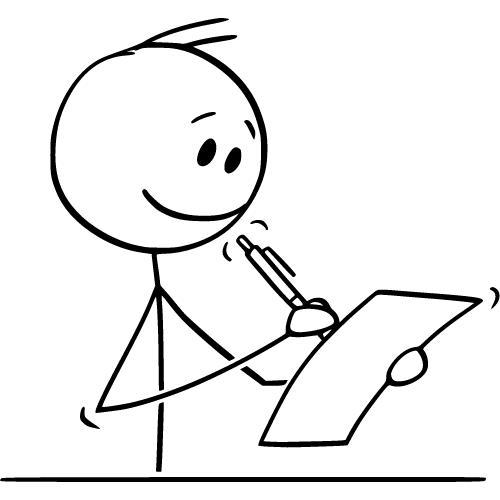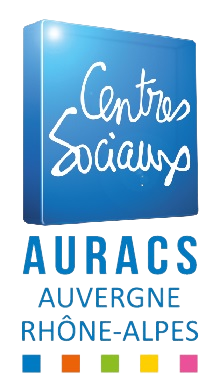- Une initiative de femmes issues de la bourgeoisie.
- Des lieux multi activités au cœur des quartiers.
- Une volonté émancipatrice.
Fin du XIXème siècle, la misère et la pauvreté s’abattent sur les ouvriers (qui n’avaient pas besoin de ça).
Heureusement, les femmes sont là.
Des dames de la haute bourgeoisie, ou des religieuses, qui vont créer les premières résidences sociales, futures maisons sociales qui donneront les centres sociaux.
Ce sont des lieux dans lesquels tout le monde peut participer, où chaque personne a sa place dans un objectif d’émancipation de classe.
Les animatrices de ces maisons y habitent et les font vivre.
1922 la création de la FSCF
- A partir de 1950 une politique publique qui favorise le développement des CS
- 1984 la création du GRACS
Une vingtaine d’établissements se retrouve pour créer la Fédération des Centres Sociaux de France (qui deviendra la Fédération des Centres Sociaux et Socio-Culturels de France, FCSF) en 1922
Les réformes économiques et sociales des années 50 (instauration de la sécurité sociale, formation continue, organisation de l’action sanitaire et sociale) favorise l’émergence des centres sociaux
L’État favorise financièrement son développement afin qu’elle accompagne le développement de centres par la procédure d’agrément des centres sociaux pour bénéficier d’aides publiques (1969), le soutien financier par le biais de prestations de service versées par la CNAF aux centres sociaux agrées (1971). L’adhésion à la Fédération relève d’un acte volontaire de chaque centre de participer comme membre actif de la fédération, et de la « reconnaissance » de l’équipement comme centre social, par la fédération.
En Rhône-Alpes, le GRACS (Groupement Rhône-Alpin des Centres Sociaux, 1984) est créé à l’initiative des fédérations de la Loire et du
Rhône. Ce groupement vise à soutenir la création de centres sociaux, mutualiser certaines actions et représenter les centres à l’échelon régional en l’absence de fédération.

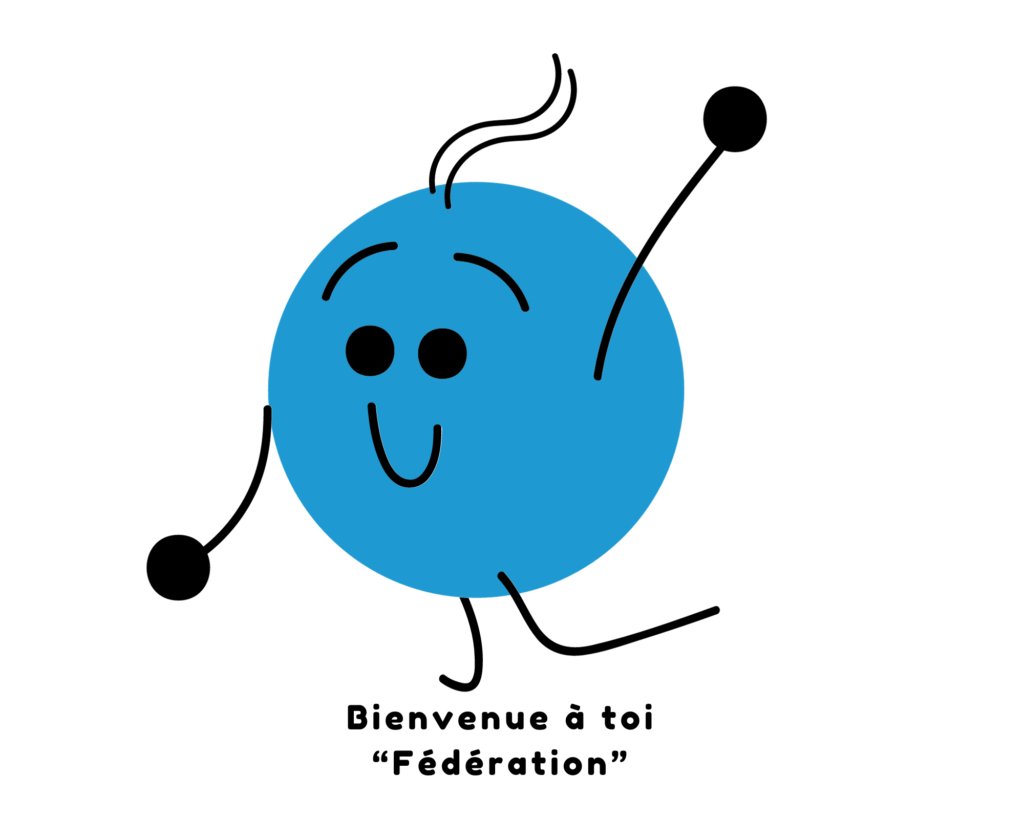
- Pour renforcer la proximité avec les pouvoirs publics locaux.
- Un projet soutenu par la FCSF et le GRACS malgré leur réticence (projet de FD jugé ambitieux).
- Dès la création, des services et du soutien proposés aux centres.
Le 14 juin 1991, 9 des 12 centres sociaux drômois se retrouvent pour préparer la transformation du Comité Départemental en Fédération Départementale.
A l’issue de cette journée, l’Assemblée Générale constitutive de la Fédération des Centres Sociaux de la Drôme adopte les statuts de la nouvelle association (publication au journal officiel en août 1992).
De 1991 à 1993, la Fédération propose un soutien technique aux centres, assure un travail de promotion auprès des collectivités locales.
Elle développe aussi des temps de formation des élus associatifs et accompagne des réflexions sur des sujets d’actualité.
La Fédération n’est pas encore porteuse d’un projet commun fort qui relierait ses membres. Aussi ce n’est pas comme le craignent la FCSF et le GRACS le nombre d’associés qui interroge dans la constitution du réseau mais plutôt l’absence de projet politique commun porté par ses adhérents.
Dès 1993 et jusqu’à 1998, les membres vont s’attacher à rédiger une charte qui se veut « être un lien entre les centres sociaux de la Drôme et donner du sens à l’engagement des bénévoles et des professionnels. »
- L’adhésion / reconnaissance
- Le développement du réseau drômois par l’impulsion d’une présidence et d’un délégué
Un texte est rédigé à partir des réalités quotidiennes de chaque centre :
« Les habitants au cœur du projet. ».
On y retrouve un certain nombre de valeurs partagées par les acteurs du réseau des centres sociaux : la solidarité, la réduction des inégalités et le principe selon lequel chaque individu est porteur de potentiels qu’il faut valoriser.
Le mode d’intervention privilégié reste l’action collective.
Les centres sociaux se présentent, d’une part, comme des lieux de valorisation des individus, de développement personnel et de coéducation.
D’autre part, ce sont des lieux d’écoute et de veille sociale, d’émergence de projets et d’actions, des lieux d’apprentissage de la démocratie notamment par l’exercice d’un pouvoir partagé.
En conclusion il est proposé que la Fédération travaille autour de deux axes de développement :
- Faire connaître au plus grand nombre le projet centre social (notamment par l’organisation d’une action départementale par an)
- Qualifier ce projet commun d’accompagnement d’initiatives en formant bénévoles et professionnels, en organisant les structures.
On sent ainsi poindre un nouveau modèle de Fédération qui tendra à se développer dans les 5 à 7 années qui vont suivre : une Fédération avec un mode d’organisation plus vertical et une normalisation des pratiques et procédures pour un projet commun et partagé : le Centre Social comme outil de développement social local (DSL).
La mise en œuvre de la charte sera d’abord axée sur des relations individuelles plus fréquentes et poussées entre la Fédération et ses membres.
La Fédération s’efforce d’aider les centres adhérents à se retrouver derrière des objectifs communs.
Une des pratiques qui se développe à cette période est l’adhésion reconnaissance : un temps de rencontre entre des administrateurs et le directeur d’un centre, le délégué et des administrateurs de la Fédération.
C’est l’occasion d’un échange sur le projet du centre social, celui de la Fédération, sur les objectifs que se fixe le centre social et les modalités d’accompagnement que peut proposer la Fédération pour les atteindre.
Le deuxième mode d’intervention est le développement de groupes de travail destinés aux acteurs des centres.
Ces rassemblements de bénévoles et de professionnels permettent la confrontation des réalités, l’expression des attentes et l’échange de pratiques. Ils constituent souvent le début d’un discours commun à l’ensemble du réseau.
Entre 2002 et 2004, deux groupes d’acteurs des centres sociaux suivront une formation au « DSL ».
Ces formations contribuent à la création d’une culture commune autour des missions et des rôles qu’entendent jouer les centres sociaux à la diffusion d’outils d’animation d’actions collectives auprès de la majorité des acteurs des centres sociaux (13 des 19 centres sociaux adhérents de l’époque sont représentés).
Le « DSL » comme cœur de métier des centres sociaux est alors clairement inscrit dans le réseau qui organise en 2005 son congrès autour de cette question.
La journée intitulée « Faisons le et ça se fera ! » donne à montrer le rôle du centre social de repérage des problématique sociales, d’accompagnateur d’initiatives d’habitants, d’interface entre les acteurs d’un territoire .
Fin 2005, début 2006, à la suite du congrès, la Fédération s’engage dans un travail de réflexion sur le projet qu’elle souhaite défendre pour les années à venir.
- Centres sociaux et associations d’animation locale dans la définition et la conduite de leur projet social,
- Animer des actions et des réflexions sur des enjeux de société,
- Favoriser la mobilisation et l’action des habitants dans l’animation des territoires (dans et hors des centres sociaux).
En 2009, la Fédération drômoise se place dans le débat public en se coordonnant à un collectif de lutte contre la pauvreté qui organise une marche en Drôme, sur l’exemple de marches ayant été organisées en Inde (mais y’avait pas d’Indous en Drôme).
Un collectif porte 26 propositions pour réduire la pauvreté en Drôme au Conseil Général.
En 2010, une formation intitulée « Animer des actions collectives avec des personnes en situation d’inégalité » poursuit ce double objectifs de placer au cœur de nos préoccupations la lutte contre les inégalités et le rôle d’accompagnement d’actions collectives que jouent les centres sociaux.
Le projet de la Fédération finalisé en 2007 se concentre sur 3 axes de travail :
- Accompagner les centres sociaux et associations d’animation locale dans la définition et la conduite de leur projet social.
- Animer des actions et des réflexions sur des enjeux de société.
- Favoriser la mobilisation et l’action des habitants dans l’animation des territoires (dans et hors les centres sociaux).
Suite à cette période de forte implication sociale, la Fédération connait une période plus difficile où les problèmes internes aux structures réduisent leurs représentation au CA.
Les « survivants » réfléchissent à une nouvelle forme de gouvernance permettant aux adhérents de mieux « s’y retrouver » dans leur implication fédérale.
Entre 2015 et 2017, le CA propose donc la création d’une gouvernance plus horizontale, permettant aux structures adhérentes de pouvoir s’impliquer dans la vie de la Fédération par plusieurs biais : forums, groupes de pairs, commissions, etc.
En 2018, quelques membres de la Fédération, sensibles à la question environnementale, préparent au fond d’un bureau obscure d’un centre social un petit texte qui fera date.
En effet, ces quelques pages proposent un engagement important dans le repérage, la prévention, le règlement des difficultés environnementales.
Ce texte enthousiasme le forum, qui souhaite le proposer comme motion lors de la prochaine Assemblée Générale de la FCSF.
Cette proposition fait bizarrement débat au niveau national, mais la motion est bel et bien déposée puis votée le 17 mai 2019 à Saint-Etienne.
Elle engage les centres sociaux au niveau national sur la voie du développement durable.
- Renforcement du travail avec la CAF 26 au tournant des années 2020 (Transitions Ecologiques Citoyennes et Solidaire – TECS, Impact Social)
- Fédération, vecteur d’innovation
Pendant ce temps, en 2018, se développait un deuxième projet important porté par la Fédération : l’évaluation de l’impact social des centres sociaux.
Lancée en Mai 2018, cette démarche est l’extension d’une expérimentation réalisée par l’espace de vie social La Coopé de Romans.
La CAF de la Drôme encourage la démarche et accompagne financièrement sa mise en œuvre.
Cet accompagnement financier deviens très vite un véritable partenariat avec un démarche co-portée au niveau régional et national.
Suite à cette première expérience, la CAF et la Fédération renouvellent l’expérience à partir de 2019 (suite à la motion, vous suivez ?) avec une démarche également co-portée au niveau départemental sur le développement durable : la démarche « TECS » pour Transition Ecologique Citoyenne et Sociale.
Malgré un petit virus qui ralentit le démarrage de la démarche, celle-ci prends de l’ampleur depuis 2021 et voit ses participants devenir de plus en plus nombreux.
Ces deux démarches font boules de neiges et sont observées de près par les autres Fédérations départementales, régionales et nationales.
- Une Fédération qui se développe en interne comme en externe
- 26 structures fédérées
- XX administrateurs
- 5 salariées… uu service d’un projet fédéral
Et maintenant ?
La Fédération compte 26 structures fédérées, dont 11 espaces de vie social et plusieurs candidats à la Fédération.
Elle compte maintenant 5 salariées (2 seulement en 2018).
Ses actions se développent, la démarche TECS prend de l’ampleur, son programme de formations internes et externes est de plus en plus fourni.
On attends plus que vous !